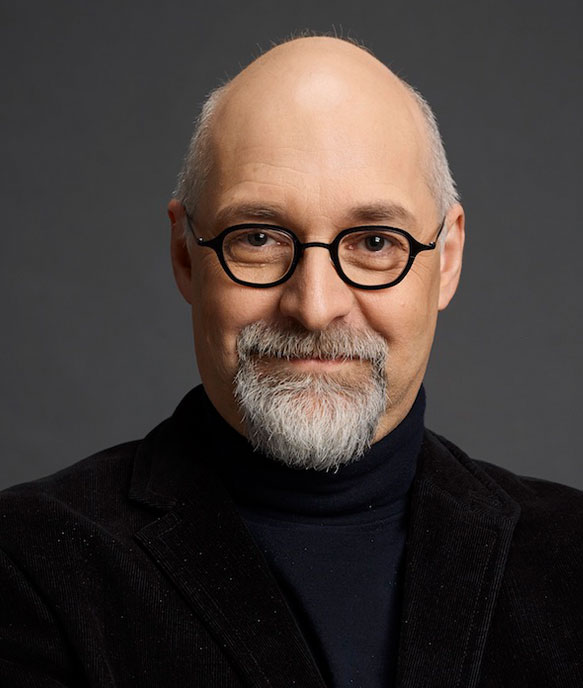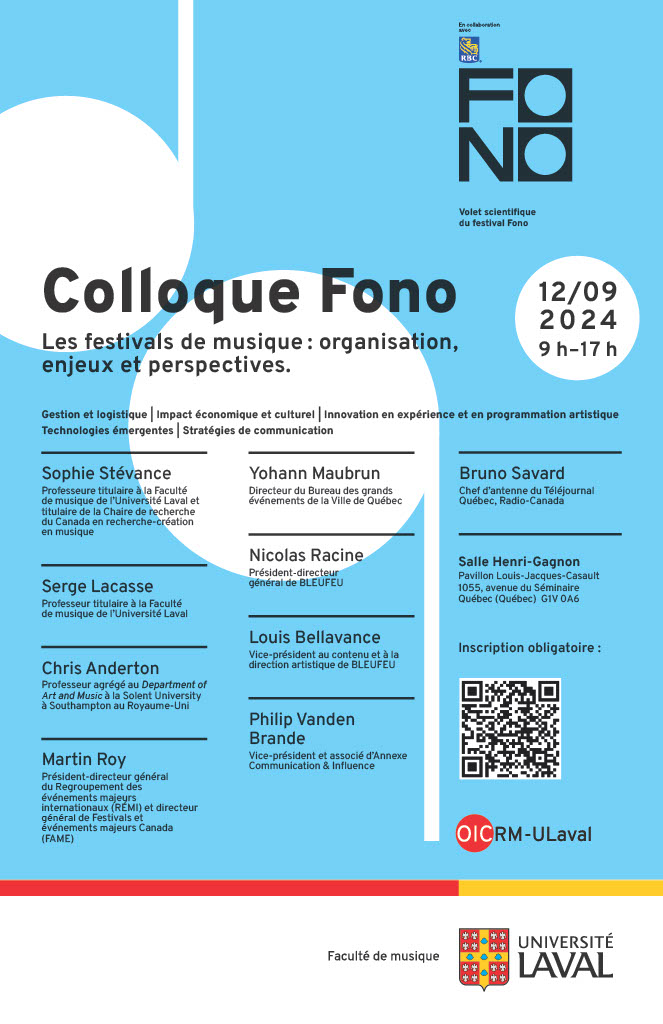Colloquium – Sarah-Anne Arsenault
1 avril 2025
Cette semaine, dans le cadre du colloquium de l’OICRM-ULaval, nous aurons le plaisir d’accueillir Sarah-Anne Arsenault, étudiante au doctorat en musicologie à l’Université Laval. Sa présentation s’intitule « Les aléas de la recherche au doctorat : la souplesse cognitive comme boussole ». En voici le résumé: « « Il faut rester ouverte aux surprises que peut faire surgir la recherche ». Ce conseil de ma directrice, j’ai tenté de le suivre durant tout mon parcours d’étudiante-chercheuse, et j’en ai éprouvé la pertinence à de nombreuses reprises. Si, au cours d’un processus de recherche, les imprévus peuvent nous déstabiliser au point de nous démoraliser ou de nous figer complètement, il est aussi possible de les appréhender comme des « surprises » qui nous invitent à repenser des portions de notre projet, souvent pour le mieux. Dans cette communication, je décrirai les aléas de mon propre parcours doctoral, lors duquel j’ai été amenée à modifier ma problématique trois fois, pour enfin arriver à mon projet actuel. Je souhaite ainsi illustrer l’importance de faire preuve de souplesse cognitive devant l’imprévu en recherche, afin de transformer les blocages et les déceptions en défis intellectuels stimulants et essentiels à notre processus. » Candidate au doctorat en musicologie/recherche-création sous la direction de Sophie Stévance, Sarah-Anne Arsenault a réalisé son mémoire de maîtrise sur le processus de co-création d’une chanson avec des jeunes. Dans son projet doctoral, soutenu par une bourse du CRSH, elle s’intéresse aux effets de la spécialisation en interprétation classique ou jazz sur les pratiques d’écoute, d’interprétation et de (co)création des étudiants. Plus largement, elle s’interroge sur l’adéquation entre les programmes en musique et la réalité du monde musical professionnel, qu’elle sillonne elle-même comme directrice vocale et compositrice depuis 2017. Avec son partenaire Dillon Hatcher, elle a co-signé la musique de nombreuses pièces de théâtre à Québec et à Montréal, l’une d’elles leur valant le Prix Bernard-Bonnier 2022-2023. En solo, Sarah-Anne a notamment composé la musique d’un des tableaux du parcours Où tu vas quand tu dors en marchant…? 2024-2025 et celle de trois chansons pour la série Passe-Partout (Télé-Québec). La présentation aura lieu via Zoom, le vendredi 4 avril, à 9h. Vous pourrez y accéder en visitant le lien suivant: Lien vers la présentation